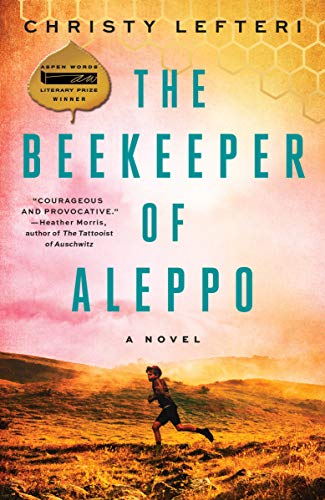Ultime tentative de Book Club dans ma nouvelle ville de résidence française, La saison des feux de Celeste Ng est l’un de ces quelques livres que tous les Books Clubs américains semblent avoir lus. Il n’en demeure pas moins une jolie surprise pour les autres membres et moi. Nous n’avons pas été les seules à adhérer à cette histoire sur fond de Wisteria Lane, puisqu’il a remporté le Goodreads Choice Awards en 2017, l’année de sa parution. Et puis surtout, le roman a fait l’objet d’une adaptation comme mini-série télévisée en 2020, avec Reese Witherspoon dans le rôle principal.
Les personnages
Famille Richardson
Elena: la mère, cheffe de famille, vit à Shaker Heights depuis plusieurs générations, écrit pour le journal local
Bill : le père, grand avocat, très peu présent dans le roman
Lexie : l’aînée, populaire au lycée
Trip : le premier fils, cliché du sportif beau gosse des lycées américains
Moody : l’autre fils, plus introverti et moins populaire, il se lie d’amitié pour Pearl et la présente à sa famille
Izzy: la cadette rebelle en opposition avec les valeurs bourgeoises de sa famille
Famille Warren
Mia : mère célibataire de Pearl, photographe qui change régulièrement de ville
Pearl : fille de Mia, née de père inconnu, très jolie
Bebe Chow : collègue asiatique de Mia (laquelle fait des extras dans un restaurant chinois pour joindre les deux bouts), veut récupérer son bébé abandonné à la naissance et désormais adopté par le couple McCullough
Linda McCullough : amie d’enfance d’Elena, après avoir essayé pendant des années d’avoir un enfant avec son mari, elle adopte
Résumé
Nous sommes dans les années 90 – dernière décennie bénie avant la révolution technologique des portables et des réseaux sociaux – à Shaker Heights, une banlieue de Cleveland dans l’Ohio. Les destins de deux familles antagonistes se retrouvent liés dans une tension qui va crescendo pour finalement exploser de manière spectaculaire. Le titre original annonce la montée : Little fires everywhere, c’est l’histoire de petits feux allumés ça et là sans forcément être remarqués, et qui se terminent en grand incendie…au sens propre comme figuré.
Telle est l’ouverture de ce roman qui commence donc par la fin. La maison de la famille Richardson est en flammes, et Lexie, Trip et Moody – les trois premiers membres de la fratrie – assistent à la scène. Ils savent très bien que c’est Izzy, leur cadette, qui a fait le coup. Ainsi, tout le roman est un flashback permettant au lecteur de comprendre comment l’adolescente rebelle est en arrivée là.
Il y a un an, Elena Richardson loue à Mia et Pearl Warren une maison du quartier qui lui appartient. Celle-ci passe de plus en plus de temps chez les Richardson grâce à une « amitié » – non réciproque, puisque le jeune homme est comme qui dirait dans la friend zone – avec Moody. Fascinée par cette famille bourgeoise, la jeune fille habituée à un mode de vie nomade et minimaliste idolâtre Lexie et tombe sous le charme de Trip.
Une réciprocité inattendue se produit, puisque Lizzie est à son tour fascinée par Mia et ses talents artistiques après que cette dernière ait été engagée comme femme de ménage par les Richardson – un job que la maman accepte dans le seul but de surveiller sa fille.
Toutefois, Mia fait sa déclaration de guerre via une histoire qui ne concerne pas directement les deux foyers. Lors d’une visite chez les McCullough, elle se rend compte que leur fille adoptive prénommée Mirabelle n’est autre que la progéniture de sa collègue Bebe, et encourage cette dernière à créer un scandale médiatique pour récupérer son enfant qu’elle regrette d’avoir abandonné un an plus tôt pour cause de difficultés économiques.
Elena découvre qui est à l’origine du scandale que doit subir la pauvre Linda et commence à enquêter sur le passé de sa mystérieuse locataire. Et elle ne va pas être déçue ! Ce qu’elle découvre résonne étrangement avec la situation présente. Quand elle était étudiante en école d’art à New York, Mia a accepté de porter l’enfant d’un riche couple stérile pour une jolie somme d’argent, puis a changé d’avis et s’est enfuie avec Pearl en prétextant une fausse couche.
Vous vous dîtes sûrement que l’intrigue a son lot de grossesses non désirées ou du moins pas très joyeuses…Dommage, car ce n’est pas fini. Lexie tombe enceinte de son petit-ami, ne le dit pas à sa famille – dans son monde, les mères adolescentes n’existent que parmi la populace ! – et demande à Pearl de l’accompagner à la clinique lors de son avortement. Pour préserver le secret, elle utilise le nom de son amie lors de sa déclaration.
Évidemment, Elena apprend la grossesse de Pearl – !!?? – alors qu’elle était en train de fouiner à la clinique pour une autre histoire. Elle soupçonne Moody d’être le père, mais ce dernier l’informe qu’elle se trompe de fils. En effet, Pearl et Trip se voient régulièrement en cachette pour copuler et le petit frère éconduit le sait depuis un moment.
La fin est proche pour le tandem Warren. Bebe n’obtient pas la garde de Mirabelle et Elena, en informant Mia de la grossesse de sa fille, la somme de quitter Shaker Heights. Izzy, furieuse en apprenant le mauvais traitement que sa mère et sa fratrie ont réservé aux deux pauvresses – et surtout à Pearl qui paye pour Lexie – allume des petits feux dans chaque chambre à coucher de la maison familiale.
Pour filer la métaphore, le dénouement est un véritable feu d’artifice. Bebe Chow kidnappe sa fille et retourne vivre en Chine. Les McCullough ne parviendront jamais à remettre la main sur « leur » Mirabelle et adopteront un autre bébé chinois. Mais la célébration des liens du sang ne s’arrête pas là, puisque Mia a pour projet de reprendre contact avec ses parents et le géniteur de Pearl. Quant à Izzy, elle vole à son tour le nom des Warren et s’enfuit à Pittsburgh, se jurant de tout faire pour ne jamais revenir à Shaker Heights, même si elle est rattrapée par la police. Il ne reste plus qu’à Elena de passer le restant de ses jours à retrouver sa fille.
La fameuse banlieue américaine et ses faux-semblants
Comme annoncé en introduction, Shaker Heights n’est pas sans rappeler Wisteria Lane – les meurtres en moins. Celeste Ng a grandi dans cette banlieue et dénonce avec moult détails et explications l’hypocrisie et le manichéisme à outrance qui règnent dans ces microsociétés. Le personnage d’Elena est éloquent ; ce n’est pas un hasard si on retrouve une Reese Witherspoon avec raie sur le côté et collier de perles dans l’adaptation en série. Persuadée d’être dans le camp du bien, Elena loue gracieusement – elle précise bien ne pas le faire pour l’argent lors de sa rencontre avec Mia – une maison à une famille monoparentale en situation précaire. Elle ne voit pas non plus l’humiliation infligée lorsqu’elle propose à sa locataire un job de bonne, mais pense sincèrement lui rendre service.
Cette dimension de lutte des classes s’exprime de manière encore plus dramatique dans le conflit entre Bebe Chow et les McCullough. Au-delà du débat sur la primauté ou non des liens du sang dans la parentalité, il y a celui – indissociable du premier, bien évidemment – qui porte sur le pouvoir de l’argent. Peut-on tout acheter ? Le confort qui entoure Mirabelle McCullough est-il préférable à l’amour de celle – aussi pauvre soit-elle – qui lui a donné la vie ? Dans La saison des feux, le narrateur à la troisième personne ne semble pas prendre parti, et la question reste pour ma part sans réponse. En revanche, les couples Richardson et McCullough – en particulier chez les personnages féminins, toujours au centre des intrigues de banlieue puisqu’elles incarnent le monde domestique, comme le prouve la série Desperate Housewives – transpirent de bons sentiments. Linda est persuadée que le bébé n’a rien à faire chez une mère sans le sous et Elena ne comprend pas non plus que cette dernière ose changer d’avis. Et comme toujours, persuadée de faire le bien, elle n’hésite pas à détruire la vie de Mia. Mais le fait-elle pour défendre son amie et rétablir une certaine justice, ou plutôt par vengeance envers une femme qui chamboule ces certitudes depuis son installation dans cette banlieue policée ?
« Même des années plus tard, Mme Richardson n’en démordra pas : elle a fouillé dans le passé de Mia uniquement pour lui rendre la monnaie de sa pièce après tout le tort qu’elle a causé. Elle a fait ça pour Linda – sa meilleure amie, une femme qui a toujours voulu bien faire avec ce bébé […] Linda ne méritait pas ça. […] Elle serait incapable de reconnaître, y compris de se l’avouer à elle-même, que tout cela n’avait strictement rien à voir avec le bébé. Il était plutôt question de Mia elle-même, d’un sentiment diffus qui l’entourait, du malaise obscur que cette femme provoquait et que Mme Richardson aurait préféré garder enfoui. »*
Les pauvres doutent, se sentent coupables – Bebe Chow en est la plus parfaite illustration – tandis que les riches ne doutent jamais de faire le Bien, ni même de ce qu’est le Bien. Quand ils sont bousculés dans leurs certitudes, ils ripostent durement et tuent dans l’œuf la moindre remise en question d’eux-mêmes. Le reste du temps, un angélisme absolu est à l’œuvre…sur fond de mépris social lui aussi absolu.
« C’était, du moins selon les limites de son imagination, une vie parfaite à un endroit parfait. Tout le monde avait cette impression à Shaker Heights. Alors quand le monde extérieur s’est avéré moins parfait – comme lorsque Brown v. Board a provoqué un tollé, que les usagers de Monthomery ont boycotté les bus et que les Neuf de Little Rock allaient à l’école sous une pluie d’insultes et de crachats – les habitants de Shaker, dont Caroline [la mère d’Elena], ont mis un point d’honneur à être au-dessus de tout cela. N’étaient-ils pas plus intelligents, plus raisonnables, plus réfléchis et prévenants, les plus riches, les plus éclairés ? N’était-ce pas leur devoir d’éclairer les autres ? L’élite n’avait-elle pas pour responsabilité de partager son bien-être avec les plus nécessiteux ? La propre mère de Caroline l’a toujours élevée dans le souci des gens dans le besoin : elle organisait des distributions de jouets à Noel, était membre de l’Association locale pour les enfants et a même supervisé la rédaction d’un livre de recettes de l’Association, dont les bénéfices étaient reversés à des œuvres caritatives »
Or le pouvoir de nuisance d’Elena est à la hauteur de son utopisme. Et ses enfants n’ont pas plus de moralité quand il s’agit de défendre leurs intérêts, comme le prouve le comportement de Lexie, prête à tout pour ne pas bouleverser le sacro-saint équilibre familial – ou, pour le dire autrement, sa réputation.
Et comme souvent dans ce genre d’histoires où tout n’est que faux-semblants et injustice, le ver est dans le fruit dès le départ, et il s’appelle Izzie. Les cadets sont les plus rebelles et indépendants, et cette petite confirme la règle. Elle n’est pas dupe et échappe à sa mère depuis le plus jeune âge. Mais la volonté de tout contrôler d’Elena ne fait qu’aggraver les choses. Une peur qui augmente la pression sur ce jeune élément perturbateur et le pousse à s’échapper pour de bon en commettant l’irréparable.
La problématique de la race
Comment aborder la question sociale en Amérique sans traiter de la race ? En cela, le roman est complet et l’intrigue autour de la petite Chow/McCullough permet de poser le problème de façon très révélatrice des considérations américaines. En France, on réfléchit selon l’appartenance à une nation et – même si l’influence de la pensée américaine est en passe de modifier cela – on écarte les soucis de race. Notre premier réflexe est de nous offusquer quand les Américains ramènent les Noirs à leur couleur de peau, par exemple. C’est oublier l’Histoire de ce pays : une terre colonisée par des Blancs à travers le génocide de ses autochtones. Sans compter la ségrégation.
Autre chose qu’a dû m’expliquer une membre américaine du Book Club tant je m’entêtais dans mon ethnocentrisme, tous les citoyens Américains – à l’exception des autochtones susmentionnés ! – ont des ancêtres qui viennent d’ailleurs. Ainsi, ils ont développé une véritable « obsession » de l’ADN, pour reprendre le terme employé par cette jeune femme. Beaucoup d’Américains font des tests ADN pour savoir quelles sont leurs origines et accordent une grande importance à celles-ci.
C’est pourquoi les McCullough font tout un cirque – hilarant tant Celeste Ng le tourne en ridicule – pour que Mirabelle garde un lien avec ses origines asiatiques. Linda lui cuisine alors du riz et lui offre un panda comme peluche. Le lecteur, même Américain, ne peut que lever les yeux au ciel. Mais pour revenir aux choses sérieuses, il y a aussi toute cette condescendance de la classe moyenne WASP à l’égard des autres races – en l’occurrence des Asiatiques. Lorsque l’avocat de Bebe Chow, lui-même Chinois, invective l’assemblée pendant le procès de sa cliente, les spectateurs présents et les médias – des Blancs pour la plupart – expriment avant tout une grande surprise. En effet, dans les représentations populaires et notamment cinématographiques, le Chinois est fourbe, sourit bêtement pour mieux faire ses coups en douce. Jamais il n’est en colère et ne se détache de cette posture de soumission. J’ai donc trouvé cette réflexion sur les clichés racistes très bien amenée, en particulier le bouleversement dans les esprits de la « race dominante » que peut induire un tel coup de pied dans la fourmilière.
Or la classe moyenne américaine blanche se trouve d’autant plus chamboulée dans ses convictions qu’elle a des opinions typiquement Démocrates, toujours bienveillantes et progressistes. Car en Amérique, la polarisation est légion : au même titre que les Républicains souvent dépeints comme des rednecks racistes et incultes, les classes supérieures démocrates instruites dégoulinent de bons sentiments et en font des caisses.
« Quand les problèmes du monde extérieur [notons le sarcasme de l’auteure dans l’emploi de cette expression !] se sont fait sentir à Shaker Heights – une bombe au domicile d’un avocat noir – la communauté s’est sentie obligée de montrer que Shaker Heights ne partageait pas ces valeurs. Une association de quartier est intervenue pour promouvoir l’intégration d’une façon typique de Shaker Heights : des prêts pour encourager des familles blanches à s’installer dans des quartiers noirs, des prêts pour encourager des familles noires à s’installer dans des quartiers blancs, des règlements pour interdire les panneaux À VENDRE afin d’empêcher le white flight ». S’en suit une description de la participation de Caroline et de sa petite Elena à la Marche sur Washington de 1963.
*Pagination non disponible puisque j’ai lu le livre en format e-book et en version originale. La traduction en français est donc entièrement personnelle. Sorry.