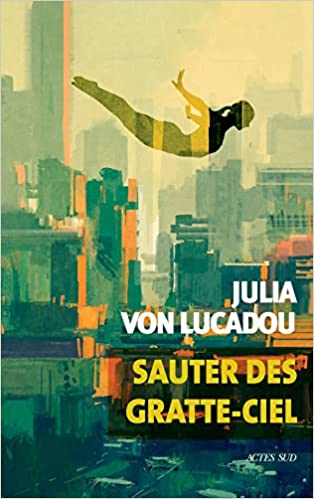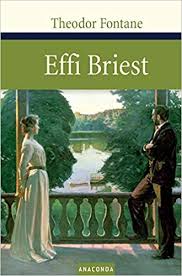Comme pour le précédent livre, je suis tombée sur Sauter des gratte-ciel au hasard d’une déambulation dans les petites allées de la bibliothèque municipale. Parfaite illustration du titre, la couverture m’intriguait. D’après la quatrième de couverture, il s’agissait d’une dystopie écrite par une jeune romancière germanophone. Pourquoi pas ? Le concept d’athlètes qui sautent des gratte-ciel vêtues d’un Flysuit m’a convaincue d’emprunter cet ouvrage. Sans surprise, le style est simple et efficace, au service d’une intrigue assez prenante. Pas étonnant, donc, que ce page turner publié en 2021 chez Actes Sud ait remporté le Prix suisse de Littérature.
Résumé
Dans un futur hyper connecté qui a l’air bien présent, il y a la ville d’une part et les périphéries de l’autre. La ville aseptisée et ses gratte-ciel se méritent. Pour tout le reste, il y a les périphéries : sales, laides et lointaines, elles abritent les parias de la société. Riva en vient et a travaillé dur pour vivre dans l’un de ces gratte-ciel depuis lesquels elle saute avec grâce. L’athlète est une star adulée pour ses performances hors du commun en partie réalisées à l’aide de son Flysuit, une combinaison spéciale qui l’arrête à l’approche du sol.
Mais dès les premières pages, on apprend que Riva ne veut plus sauter. Comme ça, sans donner d’explications, elle s’enferme dans un mutisme que même Richard, son mentor, n’arrive pas à briser. Les sponsors de la jeune athlète font alors appel à la société PsySolutions pour remettre la brebis égarée dans le droit chemin. C’est là que commence le récit narré du point de vue d’Hitomi, la jeune psychologue chargée de l’observer…
L’arroseur arrosé
Peu à peu, l’intrigue se déplace en direction de la psychologue elle-même. Non sans rappeler ce chef d’œuvre du cinéma allemand qu’est La Vie des autres, la personne chargée d’observer/écouter les autres finit par en apprendre bien plus sur elle-même que sur l’objet de son travail. Dans une prise de conscience progressive et n’autorisant plus aucun retour en arrière, Hitomi se découvre prisonnière d’un système politique qui la dépasse et contre lequel elle se rebellera. Comme dans le film évoqué, cette rébellion lui vaudra sa carrière et sa place dans la société.
Hitomi est le double de Riva. Elles étaient toutes deux promises à un bel avenir grâce à leur talent, mais surtout à leur travail acharné. Riva est parvenue à s’extraire des horribles périphéries pour devenir, avec ses nombreux followers sur les réseaux sociaux, un richissime centre de l’attention des médias. Hitomi est quant à elle un pur produit du système d’éducation bien huilé de cette société dystopique. Ses « bio-parents » ne l’ont pas élevée puisqu’elle a été confiée dès le plus jeune âge aux institutions chargées d’en faire une travailleuse exemplaire. Elle suit donc ce parcours tout tracé et devient une brillante psychologue dont la vie entière se résume à sa profession. Comme tous les citoyens des villes, son quotidien est tracké pour optimiser sa santé, ce qui inclut son activité physique, son sommeil, son alimentation et son niveau de stress. Pour l’anecdote, même ses rendez-vous galants et leurs éventuelles suites sont gérés par une application – et ni la vie de couple ni le sentiment amoureux ne semblent envisageables par le système.
Bref, le lecteur en apprend plus sur Hitomi que sur Riva. Et la vie de la jeune psychologue permet de dévoiler le fonctionnement d’un régime totalitaire où les citoyens sont surveillés et déshumanisés.
Une société fictive qui alerte sur le réel
De la résilience à la soumission, il n’y a qu’un pas
Comme toujours dans les dystopies, la fiction s’appuie sur le réel en l’étirant, et ce que le lecteur découvre dans le roman se transforme en menace pour lui-même. Sauter des gratte-ciel met en avant de nombreux travers de nos sociétés, comme cette obsession pour la résilience à coups d’exercices forcés de méditation. En l’occurrence, c’est l’apologie de la soumission. Ainsi la jeune Riva a toujours obtenu des scores de résilience élevés pendant sa formation ; il est donc surprenant qu’elle se rebelle tout à coup du haut de ses vingt-quatre ans.
Voici comment la résilience est enseignée par les psychologues du régime.
« Pendant nos études, nous avons appris à animer des entraînements à la résilience. Nos clients, des managers comme Master [N.D.L.R : le chef d’Hitomi], se déplaçaient dans la pièce, un crayon à papier en équilibre sur la tête, pour comprendre ce que c’est de n’être pas sûr de soi. De perdre l’équilibre. Le contrôle. Ils prenaient ces exercices au sérieux comme ils prenaient au sérieux toutes les tâches qui leur étaient confiées dans le cadre professionnel. » (p. 149)
Mais ce qui est le plus intéressant dans l’histoire, c’est l’aveu de soumission volontaire. Les Hommes ne sauraient être fondamentalement abrutis par un régime, car le bon sens prend le dessus dans leur esprit, mais leurs actes restent en conformité avec la doxa.
« nous avions tous conscience que cet exercice devait leur paraître complètement absurde. Aucun des hommes, aucune des femmes que nous entraînions, pas plus que nous-mêmes, ne pouvait imaginer une réelle perte d’équilibre. Nous étions trop consciencieusement voués à notre stabilité. » (p. 149)
L’hyper connectivité au service du culte de la performance et de la déshumanisation
Le culte de la performance que nous subissons tous est poussé à l’extrême dans cette dystopie. Et pour cause : les individus sont entièrement trackés – cf. les détails du tracking mentionnés plus haut – en vue d’améliorer leurs performances. Car cela reste le but ultime de cette surveillance des différents indicateurs de bien-être : on ne s’inquiète pas du manque de sommeil ou de la santé mentale des citoyens par altruisme, mais bien pour en extraire le meilleur.
Il y a les winners qui ont le privilège d’habiter de luxueux appartements dans les gratte-ciel de la ville, et les losers relégués aux périphéries insalubres. La sociologie des villes actuelles est à peine exagérée dans ce roman. Il suffit de comparer Paris aux banlieues – seule la hauteur des immeubles est inversée par rapport à cette fiction – ou encore de regarder le coût de la vie à Manhattan. Sauter des gratte-ciel apparaît comme une étape supérieure dans le cauchemar de la discrimination et de la déshumanisation.
En effet, les personnes qui vivent dans les périphéries n’ont plus aucune valeur.
Voici ce qui arrive à notre narratrice après sa chute, car contrairement à Riva pendant ses heures de gloire, elle ne saute pas vêtue d’un Flysuit et s’écrase bel et bien socialement.
« Nous avons tous déjà examiné nos credit scores, l’état de notre corps, notre courbe de performance, notre statut social, et constaté que nous ne pouvions plus rendre aucun service à la société. Que la dégénérescence de notre corps, de nos forces mentales ou de notre potentiel de productivité était déjà irrémédiablement engagée. » (p. 272)
Des mots qui résonnent malheureusement avec l’évolution actuelle de notre société, et même avec l’actualité. En repoussant l’âge légal de départ à la retraite, le message est clair : la société a besoin d’extraire nos forces quelques années de plus.
Mais le roman pousse le raisonnement du culte de la performance jusqu’au bout. Si vous ne servez plus à rien, autant mourir. Vous entendez la même petite musique que moi ? Celle qui parle de « ceux qui ne sont rien », celle qui annexe l’humanité d’un individu à sa contribution au fonctionnement de la société capitaliste et plus précisément à la performance.
C’est alors que la technologie est mise au service du suicide assisté. Les choses ne se passent pas dans les larmes et le sang, mais de manière high tech, proprement et en toute déshumanité. Ainsi la mémoire individuelle est manipulée au moyen d’applications. Tout comme – pour citer un exemple de ce que nous connaissons à l’heure actuelle – ce qui n’est pas posté en story n’a jamais existé, ce qui est effacé des memory apps personnelles n’a jamais existé. À noter que la manipulation de la mémoire et plus généralement de l’Histoire est un classique des régimes totalitaires, que l’on retrouve dans 1984 de George Orwell ou encore dans Cristallisation secrète de Yoko Ogama.
« le service de données de ChoiceofPeace™ traite les memory apps personnelles de manière qu’elles ne présentent plus de potentiel de regret. Les souvenirs négatifs sont effacés, et des souvenirs positifs ajoutés. En fonction de leur état mental, les patients peuvent avoir recours à un profil de données complètement artificiel, les images génériques d’une vie bien remplie. Ce sont ces profils artificiels qui obtiennent les meilleurs résultats en matière d’emotional index. » (p. 272)
Le tout permet de créer un bien-être artificiel et d’achever correctement les gens improductifs au crépuscule de leur vie. Ils partent donc en paix. Comme quoi, avec la technologie, tout est possible.