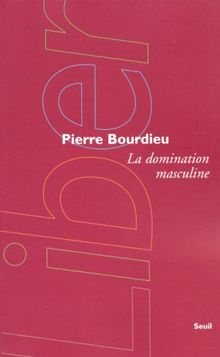Dans ma PAL depuis longtemps, j’ai enfin eu l’occasion de lire cet essai aussi court qu’exigeant dont l’approche sociologique de la domination masculine est le fondement même du combat féministe. En effet, il est primordial de comprendre l’origine et les mécanismes d’une domination sociale si on souhaite lutter contre elle et rêver à s’y soustraire. La Domination masculine n’est pas un ouvrage militant et le sociologue Pierre Bourdieu adopte une méthode scientifique pour analyser ce phénomène puisqu’il se fonde sur une étude anthropologique de la société kabyle.
On pourrait résumer ses observations en détournant une formule bien connue : « on ne naît pas homme, on le devient ». Les habitus – pour reprendre le terme scientifique employé dans le livre – ou prérogatives – pour dire ce que deviennent, in fine, ces habitus au sein de l’ordre social – masculin(e)s que l’on attribue bêtement à la biologie et que l’on s’imagine donc naturel(le)s sont en réalité des constructions sociales. Comme d’habitude dans mes analyses, je développerai les idées qui m’ont le plus interpellée.
Le mythe de la virilité
Bien avant le livre d’Olivia Gazalé paru en 2017 consacré au mythe de la virilité, Bourdieu s’attaque à cet aspect essentiel à la domination masculine. Il n’emploie pas le terme de « mythe » et ne retrace pas non plus son histoire, mais je pense que la notion de mythe est appropriée pour qualifier une telle construction de la société. La virilité est à la fois imaginaire, car créée de toutes pièces, avec des manifestations toujours contestables et contestées, et bien réelle car elle est constitutive de la division sexuelle des rôles au sein d’une société patriarcale. Pour le dire autrement, elle définit l’identité masculine et de fait, elle est également constitutive de la domination masculine.
Comme le rappelle Bourdieu, la virilité s’infiltre partout dans notre société. Tout d’abord dans ces lieux clos traditionnellement masculins et donc bien connus pour leur niveau de pression sociale à la limite du supportable, ceux qu’il appelle les « « institutions totales », […] comme les prisons, les casernes ou les internats » (p. 59). Par ailleurs, de manière plus diffuse et à mon avis encore dominante dans le monde du travail actuel, la virilité caractérise ces « nouveaux patrons de combat qu’exalte l’hagiographie néo-libérale et qui, souvent soumis, eux aussi, à des épreuves de courage corporel, manifestent leur maîtrise en jetant au chômage leurs employés excédentaires. » (p. 59) À noter que Pierre Bourdieu n’a de cesse de critiquer le capitalisme dans son œuvre, et que bon nombre d’auteurs le considèrent comme marxiste. Sa critique de la virilité dans son lien avec le capitalisme dans ce qu’il a de plus inhumain n’étonnera donc personne.
Quant à la définition de la virilité, elle s’avère aussi simple qu’indiscutable : « une notion éminemment relationnelle, construite devant et pour les autres hommes et contre la féminité, dans une sorte de peur du féminin, et d’abord en soi-même » (p. 59). Est donc valorisé ce qui s’oppose au féminin, par peur – la peur étant fondatrice de tout rejet de l’Autre – d’être un tant soit peu identifié à celui-ci.
L’hétéronomie des femmes
Dans son chapitre intitulé « Amnanèse des constantes cachées », le sociologue aborde la terrible hétéronomie des femmes, laquelle est, je dirais, à la fois une conséquence et une explication de la domination masculine. C’est l’histoire de poule et de l’œuf, en somme.
Par opposition à l’autonomie, soit la faculté d’agir selon ses propres lois, l’hétéronomie désigne la dépendance à des forces extérieures. Or comme l’indiquait la réflexion de Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, la femme est l’Autre par excellence. Dans nos sociétés androcentriques où tout est abordé du point de vue masculin, la femme se définit par ce regard. Elle est objet, tandis que l’homme est sujet.
Ce comble de la domination explique bien des choses, en particulier cette injonction à la féminité qui oblige les femmes à se montrer douces et en retenue. Bourdieu qualifie ces manières d’être attendues de « complaisance à l’égard des attentes masculines, réelles ou supposées, notamment en matière d’agrandissement de l’ego. » (p. 73) C’est pourquoi « le rapport de dépendance à l’égard des autres (et pas seulement des hommes) tend à devenir constitutif de leur être. »
Cette domination masculine qui transforme, des fait, les femmes en objets, est également à l’origine de leur triste besoin de plaire. Celui-ci les rend d’autant plus enclines « à attendre beaucoup de l’amour, le seul capable, comme le dit Sartre, de procurer le sentiment d’être justifié dans les particularités les plus contingentes de son être, et d’abord de son corps. » À partir de là, la voie est ouverte à tous les excès du capitalisme qui cherche à profiter de la situation de ces prisonnières d’un corps réel qui ne ressemblera jamais à un corps idéalisé. Car pour conclure sur ce point, ces objets du regard masculin « sont continûment orientés dans leur pratique par l’évaluation anticipée du prix que leur apparence corporelle, leur manière de tenir leur corps et de le présenter, pourra recevoir (de là une propension plus ou moins marquée à l’autodénigrement et à l’incorporation du jugement social sous forme de gêne corporelle ou de timidité) » (p. 73 – 74)
L’hétéronomie des femmes entraîne donc une dépendance à l’amour, laquelle ne peut être que source de déceptions, mais aussi un jugement permanent qui mène à l’autocensure et au manque de confiance en soi. Cette « timidité » dont parle l’auteur peut être observée de façon généralisée chez les femmes en société. Celles-ci osent beaucoup moins que ces sujets autonomes que sont les hommes, habitués depuis toujours à faire avancer leur propre existence en toute autonomie. Les objets, eux prennent moins de risques et sont habitués au/à la crainte du dénigrement d’autrui, que ce soit dans le monde du travail où dans l’espace public, comme dans la conduite automobile pour citer un exemple très concret.
Les femmes intégrées au marché du travail, oui mais…
Dans « Permanences et changements », Bourdieu s’attaque à la domination masculine qui s’exerce dans le marché du travail. L’analyse de cette domination est bien évidemment fondée sur une critique du capitalisme.
C’est un fait depuis des décennies, les femmes font massivement partie du marché du travail, mais reste à savoir quels postes elles exercent. Sans surprise, on les trouve en majorité parmi les dominés au sein de la pyramide capitaliste : « elles ont partie liée avec l’État social et avec les positions « sociales » à l’intérieur du champ bureaucratique, ainsi qu’avec les secteurs des entreprises privées les plus vulnérables aux politiques de précarisation ». (p 100) Elles deviennent alors les premières victimes du néo-libéralisme tendant à affaiblir le rôle social de l’État et à exercer parallèlement une pression croissante sur le marché du travail et sur les salaires.
Quid des femmes à des postes de pouvoir ? Le constat est malheureusement tout aussi sombre. « Les positions dominantes, qu’elles sont de plus en plus nombreuses à occuper, se situent pour l’essentiel dans les régions dominées du champ du pouvoir, c’est-à-dire dans le domaine de la production et de la circulation des biens symboliques (comme l’édition, le journalisme, les médias, l’enseignement, etc.). » Mais ce n’est pas tout, elles doivent en plus de cela fournir un double effort lié à leur condition sociale de femme, à savoir d’une part prouver leur légitimité car elles seront toujours plus soupçonnées d’incompétence que les hommes et d’autre part « bannir toute connotation sexuelle de leur hexis corporelle et de leurs vêtements ». Car pour rappel, les femmes sont avant tout perçues comme des objets sexuels et il leur faut accomplir un effort supplémentaire pour effacer tant bien que mal cette dimension de leur être-perçu lorsqu’elles veulent paraître crédibles sur le plan professionnel.
Bourdieu explique une telle répartition du pouvoir entre les hommes et les femmes par deux facteurs qui se renforcent mutuellement tout en paraissant contradictoires : le « coefficient symbolique négatif » (p. 100) qui sépare les femmes des hommes, et la séparation des femmes les unes des autres. Derrière le concept en apparence compliqué du coefficient symbolique négatif se cache simplement ce que j’ai sous-entendu à la fin du paragraphe précédent. Pour dire les choses trivialement, tout est plus difficile quand on est femme car il y a un préjugé négatif à subir d’emblée. À l’instar de la couleur de peau des Noirs ou de « tout autre signe d’appartenance à un groupe stigmatisé », ce coefficient symbolique négatif « affecte négativement tout ce que [les femmes] sont et ce qu’elles font ». À l’origine de « différences homologues », il explique ce qu’ont en commun une femme PDG qui doit affronter l’immense pression de diriger des hommes et tout simplement d’évoluer dans un monde d’hommes, et une femme ouvrière dans la métallurgie qui subit des « épreuves liées au travail en milieu masculin, comme le harcèlement sexuel » (p. 100).
Quant au deuxième facteur de séparation des femmes les unes des autres, il est assez paradoxal, puisque toutes ont ce point commun a priori rassembleur : elles subissent la domination masculine. Mais les forces sociales qui s’exercent sur les individus en les séparant sont toujours plus fortes que celles qui les rassemblent. Ainsi les femmes sont sujettes à « des différences économiques et culturelles qui affectent entre autres choses leur manière objective et subjective de subir la domination masculine » (p. 101). C’est la double peine : il y a « minoration du capital symbolique entraînée par la féminité » et en même temps différences socio-culturelles dans l’expérience même de la domination masculine.
Mais au-delà de cette répartition statistique à l’intérieur du monde du travail, la répartition entre cette sphère et la sphère privée est éloquente. La division anthropologique entre le masculin et le féminin continue d’opérer dans nos sociétés. C’est là que le titre du chapitre, « Permanences et changements », prend tout son sens. Ainsi les hommes continuent d’occuper l’espace public et les instances de pouvoir, tandis que les femmes restent maîtresses de l’espace privé, du foyer. Incluses dans le salariat, elles sont très majoritaires dans des domaines qui, selon Bourdieu, ne sont autres que des extensions de la sphère privée, tels que l’hôpital, l’enseignement ou encore ce qu’il appelle la « production symbolique (champs littéraire, artistique ou journalistique, etc.) » (p. 101). Comme par hasard, ce sont là les métiers les plus injustement rémunérés.
Et bien évidemment, c’est la voie que j’ai choisie. Or comme tous les choix, le mien ne saurait être purement individuel et personnel. Comme l’explique Bourdieu, les structures très anciennes de division sexuelle du travail agissent à travers « trois principes pratiques » que les femmes et leur entourage appliquent à leurs choix. Premièrement et comme indiqué au paragraphe précédent, les rôles dans le prolongement du foyer conviennent plutôt aux femmes. Deuxièmement, « une femme ne peut avoir autorité sur des hommes, et a donc toutes les chances, toutes choses étant égales par ailleurs, de se voir préférer un homme dans une position d’autorité et d’être cantonnée dans des fonctions subordonnées d’assistance » (p. 101). Troisièmement, l’homme est plus doué pour la technique et le maniement des machines. En conclusion, que personne ne vienne nous dire que les femmes n’ont qu’à faire d’autres choix de carrière si elles veulent sortir de la précarité !
Rappelons que cet essai est une étude sociologique et non un programme politique ou militant. Comme avec l’excellentissime Pourquoi l’amour fait mal d’Eva Illouz, on risque de se retrouver les bras ballants et encore plus démoralisé une fois la lecture terminée. Car certes, on comprend mieux les choses, mais comment se dire que scientia potentia est et ne pas sombrer dans le marasme tant les forces à l’œuvre dans la domination masculine nous dépassent ?