Sans transition, quittons le paysage industriel du Massif central pour les collines provençales. Nous sommes en 1832, au comble de la chaleur estivale de cette région méridionale, et une terrible épidémie de choléra décime les populations villageoises. Angelo, carbonaro piémontais en fuite, arrive en pleine catastrophe. Le Hussard sur le toit, c’est donc le récit de ce jeune héros qui traverse une contrée en proie à une terrible épidémie. Ça a l’air assommant résumé ainsi ? Et bien figurez-vous que ça l’est ! Comme j’ai un souvenir agréable de ma lecture de Regain pendant mon enfance, je me suis lancée pendant mon confinement avec enthousiasme à la découverte de cette histoire en lien avec l’actualité. On y trouve d’ailleurs quelques parallèles, comme la billette pour passer les barrages de gendarmerie – ancêtre de la ridicule attestation sous le COVID – le confinement, la quarantaine et la méfiance des uns envers les autres. Mais au-delà de ces éléments épars, le roman est une déception généralisée. Cinq-cents pages d’ennui mortel – sans mauvais jeu de mot. J’ai sans doute terminé ce livre à cause d’un stupide espoir, celui que soudain tout allait devenir palpitant après de nombreuses pages d’ennui.
Le lyrisme de Giono
Impossible de parler de Giono sans commencer par son style, car même s’il n’a rien pu contre ma léthargie, il m’a subjuguée. Combien de fois me suis-je sentie transportée dans cette Provence d’abord écrasée par la chaleur estivale, puis recouverte d’un brouillard automnal ? Combien de fois ai-je – un sourire aux lèvres dessiné par la beauté de mots qui s’accordent si bien – relu certaines phrases pour le plaisir de m’imprégner de ces longues descriptions ?
« Le petit chemin de terre fort doux au pas du cheval et qui montait sur ce flanc de la montagne en pente douce serpentait entre ces bosquets d’arbres dans lesquels la lumière oblique de l’extrême matin ouvrait de profondes avenues dorées et la perspective d’immenses salles aux voûtes vertes soutenues par des multitudes de piliers blancs. » (p.47)
La nature et ses éléments en sont même personnifiés et le narrateur use et abuse des comparaisons dans ses descriptions lyriques, comme ici p. 434.
« Ils marchèrent par des bois montueux, sous un ciel de plus en plus couvert qui faisait des gestes menaçants. Les coups de vent tièdes sentaient l’eau. Les trottinements de pluie semblables à ceux de rats couraient dans les feuillages. […] Elle [la forêt] était fourrée comme une peau de mouton. Elle couvrait un pays bossu, bleu sombre, sans grand espoir. Les arbres se réjouissaient égoïstement de la pluie proche. Ces vastes étendues végétales qui menaient une vie bien organisée et parfaitement indifférente à tout ce qui n’était pas leur intérêt immédiat étaient aussi effrayantes que le choléra. »
Ainsi l’environnement du héros incarne une menace, une tristesse parfois aussi. Mais la personnification a un but bien précis : transmettre une atmosphère, et les sentiments intenses que le héros ressent en traversant ce paysage de désolation.
Un peu plus près du choléra
Pas besoin de vous faire un dessin, les symptômes de l’épidémie ne sont pas ragoûtants. Cela tombe bien, car Giono ne nous épargne rien. Dès les premières pages, les corps des victimes se profilent au loin, alors que notre héros solitaire ignore encore dans quel merdier il s’est fourré. Au sein des jeux de lumières évoqués dans la première citation, la nature se montre pourtant inquiétante à la même page, et la fameuse beauté de l’horreur approche :
« Chose curieuse : les toits des maisons étaient couverts d’oiseaux. Il y avait même des troupes de corbeaux par terre, autour des seuils. » (p. 47)
Dans le passage clef du roman, à savoir la halte d’Angelo sur les toits de Manosque – je continue de trouver curieux et décevant qu’un épisode proportionnellement court, même si emblématique, soit à l’origine du titre de ce livre de 500 pages – le jeune homme parcourt les rues de la ville avec une bonne sœur afin d’évacuer les cadavres. Même s’il a assisté « le petit Français » auparavant pour tenter de sauver les cholériques, il « en fut frappé comme de la foudre. Il ne s’y habitua jamais. […] Les dernières grimaces de moribonds en bonnet de coton et caleçons à sous-pieds élargissaient dans des lèvres distendues des dentitions et des bouches de prophètes ; les gémissements des pleureuses et pleureurs avaient retrouvé les haletantes cadences de Moise. Les cadavres continuaient à se soulager dans des suaires qui, maintenant, étaient faits de n’importe quoi : vieux rideaux de fenêtre, housses de canapés […] Des pots de chambre pleins à ras bord avaient été posés sur la table de la salle à manger et on avait continué à remplir des casseroles, […] et même des pots à fleurs, vidés en vitesse de leur plante verte : […] avec cette déjection mousseuse, verte et pourprée, qui sentait terriblement la colère de Dieu. Le hennissement intime que certains ne pouvaient même pas retenir, […] pour regarder vers le ciel libre de la fenêtre (cependant de craie, torride, écœurant), était d’une grandeur magnifique, » (p. 191)
Et encore, ce n’est rien puisque les cadavres sont encore frais, contrairement à ceux de la page 316 :
« Par les portes et les fenêtres ouvertes, il vit sortir des nuages de mouches. […] c’était le spectacle attendu, mais les cadavres étaient vieux d’un mois. Il ne restait d’une femme que les énormes os des jambes dépassant d’un jupon piétiné, un corsage déchiré sur de la carcasse et des cheveux sans tête. Le crâne s’était détaché et avait roulé sous la table. L’homme était en tas dans un coin. Ils avaient dus être mangés par des poules […] »
En résumé, toujours la beauté de l’horreur, avec une dimension biblique en prime dans l’extrait p.191. Je n’ai pas été si écœurée que cela, ce n’est pas le problème ; il se situe dans la redondance de ces passages pourtant sublimes d’un point de vue littéraire. Les descriptions des visages portant le masque de la mort et de la surprise, celles des défections et décompositions des cadavres devenus de véritables festins pour toutes sortes d’animaux m’ont plus dérangée de par leurs répétitions permanentes. « On a compris, Jeannot », me disais-je à la lecture de chaque nouvelle accumulation de détails scatologiques ou autres.
Le récit de la stagnation
La cause de mon rejet massif de ce livre n’est autre que l’éternel recommencement de son intrigue. Paradoxe de ce récit de voyage : un homme très jeune et fougueux qui en plus rencontre une femme encore plus jeune et fougueuse avance – du moins sur le plan géographique – dans le but de rejoindre son ami Giuseppe puis de déposer Pauline de Théus près de Gap, MAIS chaque chapitre constitue une nouvelle histoire et non une étape. À la fin, il ne se passe rien et on comprend qu’on s’est fait chier pendant 500 pages à lire notamment des descriptions de cadavres de malades qui se sont chiés dessus avant la mort. Su-per, merci.
Au gré du long voyage et des rencontres d’Angelo, et parce que je n’ai pas pour habitude d’être injuste, quelques pensées intéressantes s’expriment toutefois via les personnages, dont celle-ci qui résonne fortement en cette période de pandémie et à l’égoïsme de certains en période de crise.
« Attention : la haine n’est pas le contraire de l’amour ; c’est l’égoïsme qui s’oppose à l’amour, […] un sentiment dont vous entendrez désormais beaucoup parler en bien et en mal : l’esprit de conservation. » (p.338)
Un peu plus loin, notre hussard s’adonne à une réflexion sur le bonheur – simple et paradoxal – inspirée par la tristesse du paysage.
« La tristesse était dans le pays comme une lumière. Sans elle, il n’y aurait eu que solitude et terreur. Elle rendait sensibles certaines possibilités (peut-être horribles) de l’âme.
« On doit pouvoir s’habituer à ces lieux, se disait Angelo, et même ne plus avoir le désir d’en sortir. Il y a le bonheur du soldat (c’est celui que je mets au-dessus de tout) et il y a le bonheur du misérable. N’ai-je pas été parfois magnifiquement heureux avec ma nonne […]. Il n’y a pas de grade dans le bonheur. En changeant toutes mes habitudes et même en prenant le contre-pied de mes notions morales, je peux être parfaitement heureux au milieu de cette végétation torturée et de cette aridité presque céleste. Je pourrais donc jouir du plus vif bonheur au sein de la lâcheté, du déshonneur et même de la cruauté. » (p. 342)
En ce qui me concerne, je trouve mon bonheur dans la littérature depuis longtemps. Inutile de dire que je n’ai pas nagé dans le bonheur pendant ma lecture du Hussard sur le toit.
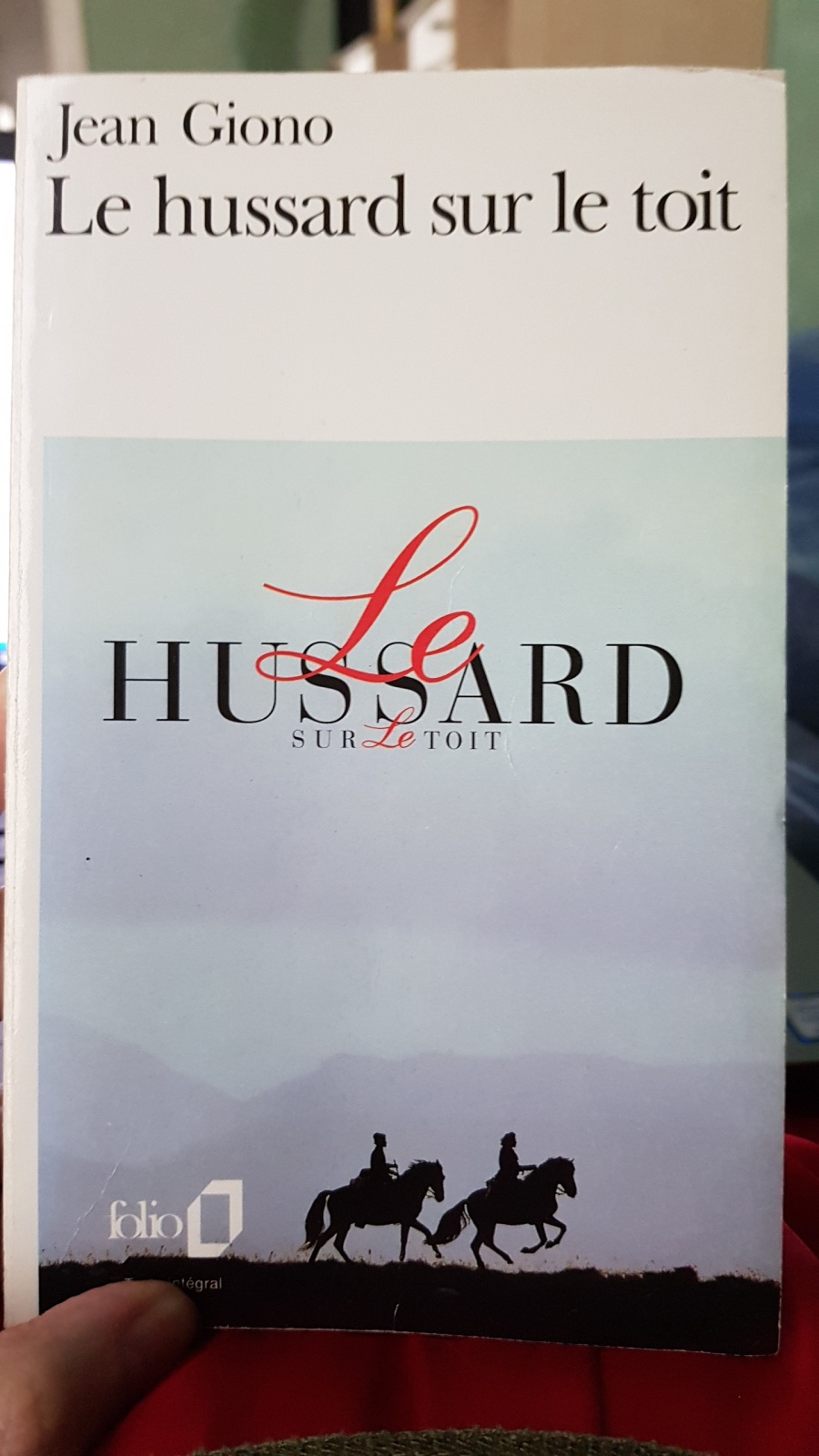
Ah, vous vous êtes ennuyée ! Vous n’avez pas nagé dans le bonheur en lisant « Le Hussard »… Vous n’avez pas perdu le contrôle en vous enfouissant dans le grenier doré où le temps s’est arrêté. Pourtant vous l’avez frôlé cette écriture sombre de Giono : « La tristesse était dans le pays comme une lumière. Sans elle, il n’y aurait eu que solitude et terreur. ».
Certains disent ses romans « noirs ». Cette encre amère qui lui vint quand la vie avait bien émoussé ses rêves de pacifisme le transformant pour les autres en son contraire : un collaborateur pétainiste, après la deuxième guerre et son emprisonnement. Alors il a vomi ironiquement ses rêves écroulés en mille et une morts de l’utopie dans laquelle il avait vécu, en vieillissement, en pourriture de chairs mortes, en désillusion. Des romans lents pour ce voyageur immobile et sédentaire… Le résultat achevé de cet acte d’écrire : « Le Hussard » (le cycle) – « Un roi sans divertissement » – « L’Iris de Suse » – « Ennemonde » – « Noé » (origines pré-familiales) – « Les Grands Chemins »… Une mutation dans l’écriture. Il s’intéresse aux complications et aux contradictions intérieures de ses personnages jusqu’à les disséquer. Exploration presque métaphysique des âmes.
Un peu comme Rimbaud laissant la poésie au bord du chemin et se faisant marchand d’armes en Afrique.
Les hommes s’usent, Ed, les corps, les rêves et les cœurs aussi.
J’ai passionnément aimé les livres de ce Giono-là. A part, dans ma bibliothèque comme l’ombre passant sur son regard clair.
Les livres ne sont pas écrits pour nous distraire, Ed. Ils sont ce que leur auteur a sué d’encre et de papier : les mots écrits quand la parole ne peut plus, ne veut plus…
« ‘Il y a de petites places désertes où, dès que j’arrive, en plein été, au gros du soleil, Œdipe, les yeux crevés, apparaît sur un seuil et se met à beugler. Il y a des ruelles, si je m’y promène tard, un soir de mai, dans l’odeur des lilas, j’y vois Vérone où la nourrice de Juliette traîne sa pantoufle. Et dans le faubourg de l’abattoir, à l’endroit où il n’y a rien qu’une palissade en planches, j’ai installé tous les paysages de Dostoïevski… » (Noé)
J’aimeAimé par 1 personne
Merci cricri. Petite précision : je ne cherche pas la « distraction » dans les livres. Le terme me paraît trop vulgaire.
J’aimeJ’aime
Impressionnant ce commentaire de Christiane. Un homme qui a connu Verdun et le Chemin des Dames n’est plus le même homme. C’est peut être l’explication de cette lenteur.
ED essaye Abattoir 5 de Kurt Vonnegut c’est de la SF construite sur le bombardement de la ville de Dresde
J’aimeAimé par 1 personne
Merci SV. Je note.
J’aimeJ’aime
Deux amies l’ont lu et détesté. Argument : « trop étrange, impossible de comprendre ce qu’il se passe dans la tête de l’auteur. Et il faut être dans des dispositions adéquates pour lire ca. »
J’aimeJ’aime
Ed, deux messages pour vous sur la RDL (mais il y a là-bas tant de commentaires que j’ai peur que vous ne les trouviez pas ! donc, les voici :
1- Ed,
ne faites pas attention. Je n’ai pas voulu vous blesser.
Vous parliez d’une partie du « Hussard ». Le cycle complet m’a rappelé une série d’Arnold Böcklin « L’Île des morts », peinte en 1880. L’île-nécropole… Où va cette embarcation ? qui est cet homme debout ?
Quand je l’ai rencontré c’était comme si ce passé que je ne connaissais pas, ni ces livres, faisaient advenir le futur. Je le sais maintenant.
(Tu ne peux dire, Ed, que ce livre est ch.iant.)
Nous avions parlé de « L’Odyssée », de « L’île mystérieuse » de J.Verne, de « Moby Dick » de Melville et d’un essai de Bachelard « L’eau et les rêves ».
C’était à cause d’une toile que j’avais peinte pour lui représentant la mort de Bobi (« Que ma joie demeure »).
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%8Ele_des_morts_(B%C3%B6cklin)
Peut-être, relire, « Noé »… écrit juste après « Un Roi sans divertissement ». Il y parle longuement du personnage Langlois.
Tout cela c’est loin, si loin…
2 – Bonjour Ed,
Grâce à vous (votre dernière chronique et notre échange), je viens de relire « Noé » de Giono.
C’est étonnant comme ce livre est lié à la problématique du billet de Passou.
Giono vient de terminer « Un Roi sans divertissement ». Il parle beaucoup du personnage de Langlois et n’arrive pas à quitter ce personnage, à aller vers un autre roman, un autre personnage. Il n’y parvient pas.
En lisant ce livre on assiste, dans son « atelier », à la naissance de ses personnages.
Le titre « Noé » ? Son « arche » c’est son cœur, son imaginaire, là où naissent tous ses personnages, là où ils prennent vie. Tout cela entrecoupé par sa vie, sa maison, sa famille, ses habitudes (la cueillette des olives – balade à Marseille – ses paysages…). Il nous balade dans ses souvenirs dans un texte bardé de digressions et d’intertextes, démesuré.
« Rien n’est vrai. même pas moi, ni les miens, ni mes amis. tout est faux. maintenant, allons-y. ici commence Noé… »
Ce chaos bouillonnant des romanciers, ce mélange de l’homme et du monde. L’homme enfermé en lui-même.
« Le monde. Un reflet. Le monde est mort comme un miroir. Il ne montre que ce que tu y mets. » disait Bobi dans « Que ma joie demeure ».
(Regardez Clopine qui déroule son histoire dans le nom des stations de métro.)
Échapper à l’enfermement en soi, en écrivant.
Démesure de ce monde pour Balzac, Flaubert, Hugo, Zola, Giono…
Et tant pis si vous vous êtes ennuyée en lisant « Le Hussard ». Nous ne sommes que des passagers dans ces grands livres. Les romanciers continuent contre vents et marées à emplir leur arche de mille et un personnages, de mille et une histoires parfois inachevées pour se sauver de l’ennui. Giono qui vit en solitaire, assis à une table, aux prises avec son œuvre.
J’aimeAimé par 1 personne
Merci cricri. Effectivement je n’ai pas toujours le temps d’aller sur la RDL donc j’aurais loupé vos messages.
J’aimeJ’aime
Bonjour,
je l’ai lu il y a une dizaine d’années et je n’ai pas oublié.
Dans le même registre, j’ai lu « La quarantaine » de Le Clézio pendant le confinement (faut être un peu maso) et j’ai beaucoup aimé. Quarantaine choléra et variole sur l’île plate près de Maurice, Remarquable roman d’atmosphère sous la plume non moins remarquable de Le Clézio.
J’aimeAimé par 1 personne
Ping : La Peste, Albert Camus – Tomtomlatomate
La description exagérée des effets du cholera n’est pas loin de Stephen King (qui lui est postérieur)
J’aimeJ’aime
Lequel ? Un habitant de mon immeuble a déménagé et laissé – près de la poubelle !!! – trois sacs de livres pleins à craquer. Il y avait qq Stephen King et je les ai pris.
J’aimeJ’aime