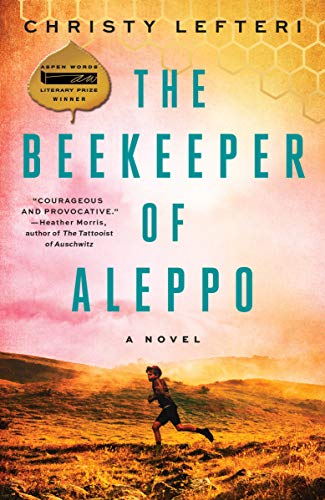Voici le premier objet littéraire que je lis portant sur une tragédie contemporaine : la guerre en Syrie et la crise migratoire qu’elle a déclenchée. Globalement, l’histoire est belle malgré son caractère inévitablement tragique, mais surtout elle est si bien racontée que le livre se lit très vite.
Rien d’étonnant à cela puisque Christy Lefteri, auteure britannique de parents chypriotes, a travaillé comme bénévole pour l’Unicef dans un camp de migrants à Athènes. Elle a donc pu récolter de nombreux témoignages et s’imprégner de l’histoire de ces gens qui lui ont inspiré celle des personnages de L’Apiculteur d’Alep.
Résumé
Dans la belle Alep, Nuri est un apiculteur bon et sensible, marié à Afra, une peintre. Avec leur petit garçon Sami, ils mènent une vie plutôt heureuse en Syrie. La guerre vient bouleverser cet équilibre et les opposants au régime de Bachar el-Assad détruisent tout autour des personnages du roman, y-compris les ruches de Nuri. Mustafa, le co-gérant des ruches et cousin de Nuri, part alors en Angleterre avec sa famille. Il s’installe dans le Yorkshire, puis y ouvre un rucher et enseigne son art de l’apiculture à d’autres migrants. Un jour, l’appartement familial explose dans un attentat. Sami meurt sous les yeux de sa mère pendant cette même explosion. Afra perd la vue et demeure longtemps sous le choc de ce qu’elle a vu. Elle refuse de quitter Alep et malgré les e-mails exhortatoires de Mustafa, le couple reste jusqu’au dernier moment dans cette ville fantôme. Très peu de civils y « vivent » encore et lorsque les hommes armés posent un ultimatum à Nuri pour qu’il les rejoigne, le départ s’impose.
Après de longues heures de route en voiture pour échapper aux contrôles, ils arrivent en Turquie. Bien évidemment, la traversée ne se fera pas tout de suite et ils logent plusieurs semaines chez leur passeur. Un jour celui-ci envoie Nuri récupérer de la « marchandise » et viole Afra pendant son absence.
Quand la nuit de la traversée de la Méditerranée arrive enfin, le récit correspond à ce qu’on a souvent entendu sur ces migrants qui prennent la mer au péril de leur vie dans des embarcations ultra vétustes. Mohammed, un petit garçon que Nuri a rencontré avant de quitter la Turquie, manque de se noyer. Il est sauvé in extremis et à partir de là, revient sans cesse lorsque Nuri, depuis son B&B en Angleterre, se remémore leur parcours de migrants.
Mais la partie la plus terrible du périple d’Afra et Nuri est à mon sens – et à celui des personnes avec qui j’ai échangé sur le roman – leur séjour interminable dans un camp de migrants à Athènes. Les frontières sont fermées et personne ne sait combien de temps ils vont rester ici. Ce camp insalubre et terreau de la violence menace de ne plus être une solution temporaire. Les conditions de vie sont décrites avec précision grâce l’expérience du terrain de Christy Lefteri. Et puis il y a sans conteste l’épisode le plus choquant du livre : cet homme qui attend seul, chaque soir près d’une pierre, et disparaît avec des enfants pour réapparaître ensuite avec des billets. Mohammed n’échappe pas à ce charmeur de serpents, bientôt tabassé et tué par une foule d’adultes vengeurs.
Un livre sur le traumatisme
Difficile d’imaginer, nous, Occidentaux, les horreurs qu’ont dû subir les migrants. L’histoire de Nuri et Afra est terrible, mais à écouter les témoignages d’autres migrants – non fictifs cette fois – on dirait presque qu’ils s’en sortent bien. Issus d’un milieu privilégié, leurs grosses économies leur permettent de payer des passeurs moins infréquentables que d’autres et de manger à leur faim. C’est dire le niveau de malheur des autres !
Dans cette histoire racontée du point de vue d’un personnage masculin rêveur, la douceur est de mise dans la narration. Pas de pathos, pas de misérabilisme, mais un sentiment de fatalité qui inonde le récit. Le narrateur sait qu’il doit continuer à vivre, qu’il devra s’adapter à un pays gris et radicalement opposé au sien, reprendre sa raison de vivre qui est l’apiculture, aimer sa femme alors qu’il n’a pas su la protéger et ne peut quasiment plus la toucher et surtout…vivre sans leur fils. Leurs traumatismes respectifs sont opposés et complémentaires. Afra ne voit plus ce qui est, tandis que Nuri voit ce qui n’est plus.
À force de va-et-vient permanents entre un présent dans un hôtel en Angleterre et un passé douloureux, le lecteur devine très vite la vérité révélée à la fin du récit : Mohammed n’existe pas et Afra n’est pas aveugle – du moins pas sur le plan médical/physique. L’hallucination et le handicap sont les conséquences du traumatisme de la perte d’un enfant pour ce couple endeuillé à vie. Ils doivent désormais réapprendre à vivre ensemble – notamment dans l’intimité – et à appréhender à nouveau leur passion. D’ailleurs, aucun des deux ne l’a délaissée ; pas un seuil instant. Le regard – ou plutôt l’esprit – de Nuri s’arrête régulièrement sur des abeilles et Afra n’a jamais cessé de dessiner et de peindre malgré sa cécité. Se raccrocher à ce qui nous définit, continuer à vivre grâce à l’action – et ce n’est pas ce qui manque ici –, c’est peut-être cela le secret de la résilience.
Comme toute œuvre littéraire, L’Apiculteur d’Alep pose des questions et n’a pas vocation à donner des réponses. L’auteure le précise dans l’interview retranscrite à la fin de mon édition en anglais : à travers cette histoire de deux traumatismes, elle a voulu poser la question de « qu’est-ce que voir ? ». Et si Afra était moins aveugle que son mari qui refuse de faire le deuil de Sami en reportant son amour sur Mohammed ? Et si être aveugle n’était pas finalement la seule solution pour se protéger des horreurs du monde ? Quant aux citoyens Occidentaux, ne ferment-ils pas, eux-aussi, les yeux face à une réalité trop insupportable ?
Un véritable roman, pas un manifeste pro-migrants
Dans ce roman rempli d’humanité et de nuance, le lecteur ne subit aucune leçon de morale ni discours culpabilisant à l’égard des Occidentaux. Ainsi le rejet des migrants de la part des Grecs n’est pas présenté comme injuste et dégueulasse – il est objectivement compréhensible ! – et le calvaire administratif pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologue pour Afra est décrit de manière purement factuelle.
Comme je l’ai évoqué plus haut, la jeune auteure connaît son sujet. Ce contact quotidien et prolongé avec les semblables des futurs protagonistes de son roman se retrouve dans la précision des détails qui « sentent le vécu ». La destruction d’Alep, le départ de Syrie, l’intervention des passeurs en Turquie, mais surtout de l’horreur du camp de migrants en Grèce – cette halte qui prend des allures de porte l’enfer…tout semble réaliste. Sans rien y connaître, je peux cependant affirmer ne pas avoir eu l’impression de lire la fiction purement fantasmée d’une Occidentale apitoyée mais déconnectée de cette crise migratoire. Ouf !
Voilà pour la partie « historique », si on peut parler d’histoire contemporaine. Mais Christy Lefteri n’est ni essayiste ni journaliste, et je veux surtout montrer ici que L’Apiculteur d’Alep est avant tout un beau roman, avec une histoire individuelle agréable à lire. Or on peut attribuer le plaisir de lecture à l’absence de violons en fond sonore du film que le lecteur se fait dans sa tête. La douceur est présente du début à la fin du roman grâce à ce narrateur sensible. Les couleurs et les parfums d’Alep sont merveilleusement racontés, la sensibilité de sa femme artiste transparaît tout au long du récit, tout comme l’amour que son mari lui porte. Ajoutez à cela la pudeur qui règne dans la narration de l’horreur – sans accumulation de détails glauques ou violents inutiles – et vous aurez la recette d’un roman réaliste mais pas spectaculaire.
Le symbole des abeilles
Par ailleurs, le motif principal du livre, à savoir les abeilles, n’échappe pas à cette précision. À la fin de mon édition originale, un entretien avec Christy Lefteri révèle qu’elle a longtemps échangé avec un apiculteur syrien lors de son bénévolat à Athènes. Tant mieux, parce que ça se voit.
Je le répète : Nuri est un rêveur. Sa passion pour les abeilles est en parfaite adéquation avec sa personnalité. Le travail du plus efficace des pollinisateurs représente un certain idéalisme. Le tout début du roman, quand Nuri vit encore paisiblement et sereinement de sa passion avec son cousin Mustafa, décrit très bien le processus de pollinisation. En bref, l’abeille recueille le nectar et le pollen d’une fleur. Une partie du pollen des étamines, l’organe reproducteur mâle de la fleur, colle à l’abeille. Celle-ci se pose ensuite sur une autre fleur et permet ainsi le contact entre ce pollen et le stigmate ou le bout du pistil – organe reproducteur femelle – de cette autre fleur. Le tout permet la fécondation et la naissance d’un fruit portant des graines.
Les abeilles sont donc vectrices de reproduction végétale. Elles donnent la vie. Nous avons un narrateur fasciné par le monde des abeilles qui va être propulsé dans son exact opposé : le monde des hommes et de la guerre. À noter que, comme chacun sait, les abeilles sont en danger. La paix aussi, sauf qu’elle l’a toujours été. Cette opposition entre l’idéal de vie fragile incarné par les abeilles et le réel morbide des hommes est reprise dans un e-mail de Mustafa à son cousin et partenaire :
« Mais n’oublie pas que la route est encore longue. Tu dois apprendre à marchander. Les gens ne sont pas comme les abeilles. Nous ne travaillons pas main dans la main, nous n’avons pas vraiment le sens du bien commun – je viens de m’en rendre compte. »
Alors oui, cela paraît niais, mais je vous assure que ce roman est à la fois très beau et solaire malgré l’horreur qu’il n’élude jamais. À lire !